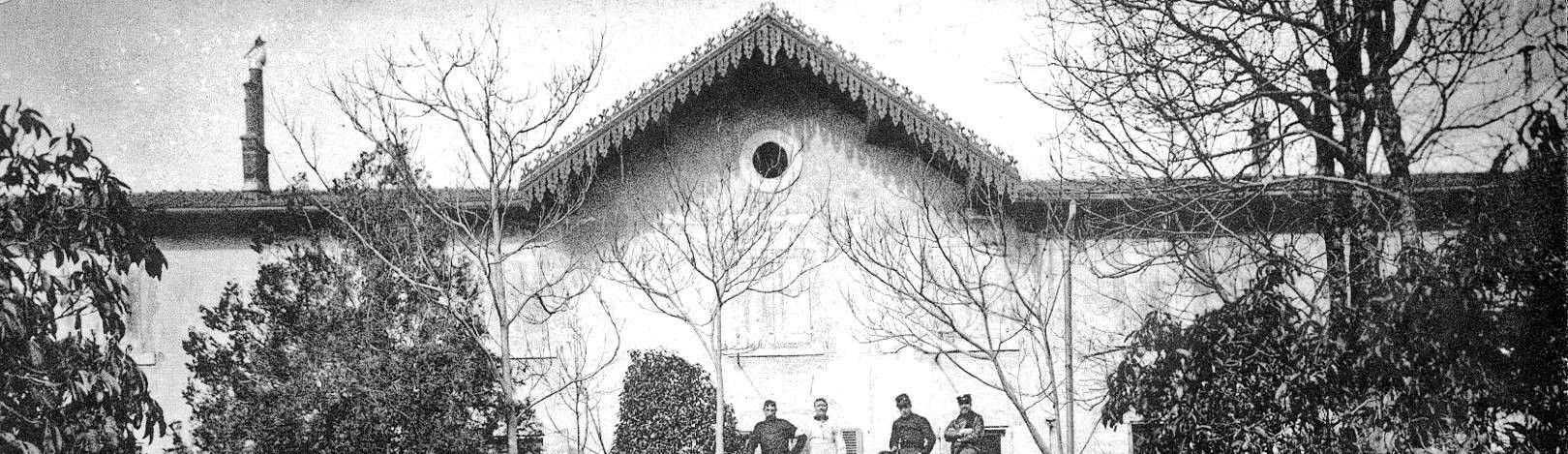Philippe NIVET, La France occupée, 1914-1918 (par P. Salson)
Philippe NIVET, La France occupée, 1914-1918, Paris, Armand Colin, 2011, 480 p.
Un après Annette Becker[1], c’est au tour d’un autre historien du Centre de recherche de l’Historial de Péronne de publier un ouvrage de synthèse sur l’occupation 1914-1918, ici étudiée seulement dans le cadre du territoire français.
Philippe Nivet considère que l’heure serait désormais venue de dresser une synthèse de la floraison, à partir des années 1990, de mémoires universitaires portant sur cette expérience d’occupation. Il s’appuie également sur une recherche personnelle visant à collecter des récits de l’occupation d’origines variées (témoignages publiés, enquête auprès des instituteurs conservée à la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, procès-verbaux de rapatriés ou de « personnes suspectes »…).
Une occupation envisagée sous quatre angles
Le regard est d’abord porté, dans une première partie, sur l’occupant qui opérerait une « germanisation » du territoire. Philippe Nivet s’emploie à en décrire les signes ; selon lui, « l’occupant considère donc comme sien le territoire envahi » (p. 84). La preuve en serait apportée par l’ampleur des réquisitions, des pillages et des contributions exigées. L’occupant chercherait ainsi à détruire l’industrie du Nord de la France pour qu’elle ne puisse faire concurrence à l’industrie allemande après-guerre (p. 101). Le ton de l’ouvrage dans cette première partie paraît fortement influencé par les publications de l’entre-deux-guerres qui dénonçaient un plan allemand préétabli de démantèlement de l’économie française, voire d’exhaustion[2].
À partir de la deuxième partie, Philippe Nivet se focalise sur la population occupée avec un objectif : « rendre compte au plus près de la vie des occupés » (p. 11), d’où la part prise par les témoignages. Et cette deuxième partie s’attache à décrire le quotidien des occupés entre privations, travail forcé, déportation… C’est donc un portrait de l’occupé victime de la guerre qui se dessine ici.
La troisième partie porte sur l’attitude de la population analysée à partir des catégories définies, et désormais critiquées, par les historiens de la Seconde Guerre mondiale : Résistance, accommodements, Collaboration. Philippe Nivet justifie ce choix en rejetant les définitions trop restrictives de la Résistance pour privilégier ce qu’en a dit Jacques Sémelin, c’est-à-dire « un processus spontané de lutte de la société civile par des moyens non armés » (p. 207). Il ne revient pas en revanche sur le débat historiographique autour du thème de l’accommodement[3]. D’ailleurs, il utilise davantage le terme de rapprochement pour qualifier les formes de familiarité qui se créent entre le soldat logé et les familles françaises, rapprochement pouvant aller jusqu’aux relations sexuelles.
Enfin, dans une dernière partie, la borne chronologique de 1918 est dépassée pour s’intéresser au devenir des occupés après-guerre. C’est là l’apport le plus important de l’ouvrage, Philippe Nivet décrit une société tiraillée par de nombreuses tensions, très loin de l’euphorie unanime de la victoire : désillusion devant les difficultés de ravitaillement, sentiment d’avoir été oublié pendant quatre ans, désir de vengeance contre ceux et surtout celles qui s’étaient compromis.
Un travail fondé sur une documentation variée mais peu mise en perspective
La démarche adoptée par Philippe Nivet est largement descriptive. Son désir de rendre du quotidien des civils occupés le conduit à brasser une masse considérable de récits de natures différentes (journaux intimes, procès-verbaux d’interrogatoire, articles de journaux…) et d’études monographiques provenant de travaux d’étudiants. L’ouvrage comporte d’ailleurs la liste des sources imprimées utilisées et une bibliographie détaillée. En cela, il se distingue de la précédente synthèse sur l’occupation[4], L’auteur lui-même insiste sur ces différences en affirmant que « la plupart des sources archivistiques utilisées pour le présent volume ne l’ont pas été » par Annette Becker (note p. 401).
Son histoire de l’occupation couvre alors l’ensemble des territoires occupés en France, de la région lilloise jusqu’aux Vosges « afin de ne pas limiter, comme souvent, l’histoire de l’occupation entre 1914 et 1918 au département du Nord » (p. 11). Cette analyse du quotidien permet de dresser un tableau assez nuancé des relations entre occupés et occupants. L’ampleur du rapprochement entre les civils et les soldats logés n’est pas niée et les récits en donnent de nombreux exemples. Des tensions sociales fortes s’expriment également au sein de la population civile occupée comme en témoignent les dénonciations pendant la guerre, puis les rancœurs d’après-guerre. La première partie de l’ouvrage laisse en revanche le lecteur sur sa faim. La germanisation n’est décrite qu’à partir de récits français, donc ennemis. Aucune documentation allemande ne vient confirmer cette hypothèse d’un tel mode d’administration. De manière générale, la bibliographie utilisée reste très franco-française.
Autre regret, les nombreux témoignages utilisés ne sont pas critiqués : au contraire, ils prennent place dans l’argumentation comme preuve de l’hypothèse avancée. Le lecteur peut alors légitimement se poser plusieurs questions :
Premièrement, un témoignage est-il automatiquement fiable ? Un écrit du for intérieur, un procès-verbal d’interrogatoire, un récit rédigé à l’intention de ses supérieurs hiérarchiques peuvent-ils être considérés comme équivalents ? La condition de production de ce récit ne peut-elle pas influer sur ce qui est dit ?
Deuxièmement, peut-on généraliser une situation décrite dans plusieurs témoignages ? En quoi les récits collectés sont-ils représentatifs ? Philippe Nivet procède par succession d’exemples et de témoignages venant de lieux différents pour confirmer, voire démontrer une affirmation. Mais jamais le récit n’est replacé dans le contexte social, territorial ou temporel, comme si la réalité vécue par un bourgeois citadin était la même que celle d’un petit paysan. Or l’occupation a-t-elle été vécue partout de la même manière ? Ou y a-t-il des spécificités locales ? L’expérience est-elle la même pour toutes les catégories sociales ? N’y a-t-il pas des évolutions au cours de la période ?
Enfin, la réalité décrite par les témoignages deviendrait exemplaire de ce qu’est l’occupation entre 1914 et 1918 puisqu’elle n’est pas comparée à d’autres territoires occupés ou à d’autres expériences d’occupation. Par exemple, Philippe Nivet évoque les pillages et les destructions ainsi que les souillures laissées par les soldats dans les maisons où ils pénètrent au moment de l’invasion (p. 31). Ces faits semblent témoigner de la violence et de la haine envers l’ennemi. Or ce n’est pas une situation exclusive de l’occupation, Emmanuel Saint-Fuscien a décrit le même genre de faits du côté français[5]. Ces violences sont davantage typiques des débordements que peuvent provoquer des troupes fatiguées après des combats violents, que de l’occupation en tant que telle. Il en est de même pour la pratique des otages lors de l’invasion : elle n’est pas nouvelle, les officiers reproduisent des solutions que l’armée prussienne avait adoptées lors de la guerre de 1870-1871.
Une histoire qui s’inscrit dans la continuité de l’approche culturelle du Centre de recherche de Péronne
D’autre part, Philippe Nivet reprend sans analyse critique les postulats caractéristiques de l’histoire culturelle (voir le répertoire critique établi par André Loez et Nicolas Offenstadt : http://www.crid1418.org/espace_scientifique/textes/conceptsgg_01.htm). Il fait référence par exemple à « une culture de guerre » caractérisée par l’obsession de l’odeur de l’ennemi (p. 31).
À la suite d’Annette Becker, Philippe Nivet parle de « renversement de l’ordre sexué » pour caractériser une déportation des Lillois à Pâques 1916 perçue comme étant exclusivement féminine (alors qu’une part non négligeable d’hommes est également déportée). Il décrit ainsi ce renversement : « des femmes ont dû travailler comme les hommes, des bourgeoises ont été traitées comme des prostituées, des jeunes filles comme des femmes mûres » (p. 148). On voit que le renversement de l’ordre sexué devient inconsciemment renversement de l’ordre social. Mais surtout un processus aussi complexe que le renversement de l’ordre sexué n’est confirmé que par un seul témoignage qui dénonce le fait que les jeunes filles, innocentes et pures, soient regroupées avec des hommes.
Philippe Nivet rejoint également Annette Becker sur l’affirmation d’un unanimisme patriotique au sein de la population occupée. Il argumente ainsi à propos de la rareté des condamnations pour « intelligence avec l’ennemi » après-guerre : « leur faible nombre révèle, au contraire, l’ardent patriotisme dont ont fait preuve, entre 1914 et 1918, les populations locales » (p. 364). Là encore, on aurait aimé davantage d’explications. En quoi le fait de ne pas commettre le crime d’ « intelligence avec ennemi » est-il le signe d’un ardent patriotisme de la population occupée ? Le choix était-il pour un civil occupé entre la trahison et l’ardent patriotisme ? Les convictions personnelles peuvent-elles être révélées par les actes individuels ?
Dernier point commun enfin avec Annette Becker, c’est l’idée que l’occupation a consisté en un « véritable régime de « terreur » » (p. 373) et Philippe Nivet justifie ce terme par sa présence dans plusieurs témoignages. Il est vrai que les témoignages parlent de terreur, de joug, de Barbares. Mais cela correspond-il pour autant à la réalité de l’occupation ? La terreur renvoie à un régime autoritaire pratiquant une répression massive à l’aide d’une justice expéditive. Est-ce le cas de la France occupée entre 1914-1918 ?
Finalement, le recours à des telles affirmations pose plus de questions qu’il n’apporte des éclaircissements sur l’occupation en France de 1914 à 1918.
Avec La France occupée, 1914-1918, Philippe Nivet s’inscrit donc dans la continuité d’une histoire culturelle. L’argumentation s’appuie sur quelques postulats (germanisation, renversement de l’ordre sexué, unanimisme patriotique) qui sont étayés par des témoignages qui, hélas, sont insuffisamment critiqués. Il manque une réflexion sur les conditions de validité de telles affirmations : pour quel territoire, pour quelle période, pour quelles catégories de population sont-elles valables ? Peuvent-elles être généralisées à l’ensemble de la France occupée ?
Toutefois, Philippe Nivet parvient à esquisser de nouveaux aspects de l’occupation quand il étudie l’après-guerre ou les rapprochements entre civils occupés et soldats allemands. En fait, la lecture de La France occupée, 1914-1918 laisse voir, malgré l’affirmation précédemment citée de l’auteur, que la population occupée n’est pas un bloc homogène, unanimement patriotique : de fortes tensions la parcourent. Le clivage national n’est pas en outre indépassable, d’où les échanges qui s’établissent entre soldats et civils occupés. Ainsi, les civils font progressivement la distinction entre l’autorité d’occupation et le soldat allemand, ce qui remet en cause les représentations que l’on avait de l’ennemi. On voit par là que le raisonnement à plusieurs échelles (à l’échelle de la France occupée, à l’échelle d’une commune occupée, à l’échelle individuelle) est nécessaire pour rendre compte de toute la complexité de l’expérience de l’occupation.
[1] Annette BECKER, Les Cicatrices rouges 14-18. France et Belgique occupées, Paris, Fayard, 2010, 373 p. (voir la recension qui en avait été faite : http://www.crid1418.org/bibli/?p=95)
[2] Georges GROMAIRE, L’occupation allemande en France (1914-1918), Paris, Payot, 1925, 501 p.
[3] Notion développée par Philippe BURRIN, La France à l’heure allemande. 1940-1944, Paris, Seuil, 1995, 559 p. mais critiquée par Pierre LABORIE, Le Chagrin et le Venin. La France sous l’Occupation, mémoire et idées reçues, Paris, Bayard, 2011, 356 p.
[4] Annette BECKER, op. cit.
[5] Emmanuel SAINT-FUSCIEN, « » Forcer l’obéissance » : intentions, formes et effets d’une pratique militaire dans l’activité combattante de la Grande Guerre » in André Loez et Nicolas Mariot, Obéir/désobéir. Les mutineries de 1917 en perspective, Paris, La Découverte, 2008, p. 40
FABBRI Fabio, Le origini della guerra civile. L’Italia dalla Grande Guerra al fascismo, 1918-1921 (par Marco Pluviano et Irene Guerrini)
Reflets et influences de l’expérience de guerre dans la violence fasciste en Italie de 1919 à 1922 dans la récente production historiographique
(Recension par Irene Guerrini et Marco Pluviano)
Au cours de ces dernières années, deux livres ont été publiés en Italie au sujet de la violence fasciste qui accompagna les années précédant le coup d’État connu comme « la marche sur Rome » : l’étude de l’historien italien Fabio Fabbri, Le origini della guerra civile. L’Italia dalla Grande Guerra al fascismo, 1918-1921, Torino, UTET, 2009, et le travail de l’historien allemand Sven Reichardt, traduit sous le titre Camice nere, camice brune. Milizie fasciste in Italia e in Germania, Bologna, Il Mulino, 2009 (Faschistische Kampfbünde. Gewalt und Gemeinschaft im italienischen Squadrismus und in der deutschen SA, Köln, Bohlau Verlag, 2002).
Il doit être clair qu’il s’agit de deux études différentes entre elles. La première affronte le sujet du développement de la violence du « squadrismo » (l’ensemble des bandes armées fascistes) dans un cadre qui, pour l’auteur, se configure comme une véritable « guerre civile » menée par les fascistes contre les socialistes, les syndicalistes et, à partir de janvier 1921, les communistes, avec le plein soutien des catholiques, des libéraux et du patronat agraire et industriel, de l’armée et de la plupart des organes politiques et administratifs de l’État démocratique.
Le second auteur, par contre, se concentre principalement sur l’analyse des caractéristiques sociales, professionnelles, culturelles des membres des milices fascistes en Italie et en Allemagne, en développant un examen de type comparatif. En outre, il consacre beaucoup d’attention à l’examen des dynamiques de groupe, des mécanismes identitaires, et à l’étude du développement de l’esprit de corps, en mettant ceci en relation avec les origines sociales des individus et avec leur situation professionnelle. En ce qui concerne l’Allemagne, Reichardt détermine dans la « communauté militante » un élément substitutif de la famille pour les jeunes S.A. (Sturmabteilung). Ces derniers, étant victimes du chômage grandissant, laissaient leur famille ou en étaient souvent expulsés, et ils n’étaient pas aptes à s’en créer une propre.
En considération de ceci, et d’autres éléments de grand intérêt, nous voulons analyser ici une des composantes de l’expérience du « squadrismo » italien qui émerge avec vigueur de l’examen des deux ouvrages : l’importance fondamentale de l’expérience de guerre.
On sait bien que la Grande Guerre constitua un des principaux éléments constitutifs pour toutes les forces politiques d’extrême droite dans l’immédiat après-guerre, soit dans les pays dans lesquels elles conquirent ensuite le pouvoir, soit dans ceux dans lesquels l’État démocratique les maintint aux marges, après les avoir éventuellement utilisées dans la lutte anti-prolétarienne.
Ce que montrent les deux livres, c’est que, parlant de l’expérience de guerre, on ne doit pas se limiter à rechercher en elle « l’ADN » du fascisme, mais qu’il faut montrer qu’elle en a accompagné le développement et la croissance d’organisation, en représentant tout d’abord un des facteurs fondamentaux pour la survie et par la suite pour le triomphe du mouvement de Mussolini.
Le rappel de la Grande Guerre ne se limitait donc pas à l’adoption de termes du langage des soldats, ou à la réitération de l’expérience héroïque par antonomase afin de galvaniser les jeunes qui n’avaient connu la guerre que par les journaux, ou l’avaient connue par les récits des frères aînés, ou l’avaient idéalisée à travers la mythisation de la mémoire de quelque conjoint mort au combat. La guerre donna en effet au fascisme les atouts qui permirent à un mouvement ultra-minoritaire de vaincre assez rapidement une organisation socialiste et syndicale très forte, enracinée dans tout le pays, douée d’une expérience d’au moins trente ans dans la mobilisation, et qui ne reculait pas devant l’affrontement physique.
Tout de suite le fascisme assimila les modalités très modernes, au moins pour l’Italie, d’organisation des hommes que la guerre avait développée surtout dans la dernière année et demie. Ce n’est pas un hasard si le corps militaire de référence, soit du point de vue de l’autoreprésentation des « squadristi » (membres des bandes armées fascistes), soit en ce qui concernait l’organisation pratique des « Squadre d’azione » (équipes d’action fascistes), fut celui des « Arditi » (les fantassins spécialement entraînés pour remplir des missions dangereuses), qui avait constitué un des éléments de majeure nouveauté dans l’expérience de guerre italienne. Ainsi, comme les Arditi avaient privilégié l’action démonstrative par surprise, menée par de petits groupes fortement autonomes, commandés par des officiers subalternes, les fascistes basèrent leur stratégie de pénétration et conquête des citadelles rouges – surtout dans les campagnes et les petites villes – sur les équipes d’action. Ces équipes étaient guidées par des jeunes, souvent ex-officiers ou sous-officiers (fréquemment ex-Arditi) ; elles évoluaient avec grande rapidité sur des véhicules fournis par des propriétaires terriens et des industriels ou, souvent, « laissés sans surveillance » par l’armée ; elles visaient toujours à obtenir des résultats symboliques de nature militaire comme, par exemple, la capture des enseignes socialistes, l’élimination du drapeau rouge des sièges communaux administrés par le parti socialiste, l’humiliation publique des dirigeants adverses, la destruction des « centres de commandement » ennemis (Chambre du travail, siège de parti, siège des coopératives). Les expéditions, réalisées souvent la nuit comme les actions des Arditi, avaient la caractéristique d’une incursion plus ou moins longue en territoire ennemi, conduite avec l’objectif de frapper et désarticuler l’organisation adverse, plutôt que de maintenir le contrôle du territoire (à cela on arrivera plus tard, à partir de 1921).
Le lien très étroit des techniques de la violence fasciste et de celles de la guerre fut orgueilleusement revendiqué même par les « gerarchi » (chefs politiques fascistes) locaux et les sommets nationaux, et il servit sûrement pour confirmer, dans la masse des sympathisants, l’identification entre la défense de la patrie menée par les Arditi et celle de la bourgeoisie (soit comme classe sociale, soit comme dépositaire des valeurs de la civilisation face à l’invasion de la marée subversive), défense menée les armes à la main comme le voulait la propagande des disciples de Mussolini.
L’appropriation de l’héritage de guerre ne se limita pas à une aussi essentielle utilisation des tactiques militaires. Un autre instrument décisif que les fascistes réussirent à obtenir et à maintenir solidement fut la participation à leurs entreprises de militaires en service, surtout des officiers. Pour comprendre ceci, il faut considérer que la démobilisation de l’armée italienne fut lente, pour des raisons d’ordre militaire (tensions avec la Yougoslavie voisine, expéditions à l’étranger, conflit de Fiume à partir de l’automne 1919), ou d’ordre politique (utilisation continue de l’armée en service d’ordre public contre des ouvriers et des paysans).
Il y eut encore une autre raison qui contribua à maintenir en service une force disproportionné par rapport aux nécessités : la difficulté de replacer dans le monde du travail les militaires libérés, particulièrement les officiers. Le marché du travail n’offrait pas, en effet, de places suffisantes à la hauteur des aspirations mûries par des hommes qui s’étaient habitués à l’exercice du commandement sans avoir, surtout ceux des dernières levées, les nécessaires compétences culturelles et professionnelles ; à partir de 1917, en effet, pouvaient participer aux cours pour devenir officier de complément les jeunes qui avaient seulement fréquenté au moins deux ans d’institut supérieur. En conséquence de ceci, les officiers restèrent en service en proportion supérieure à celle des soldats, en obtenant aussi l’autorisation de fournir un service très léger dans les villes mêmes où ils reprenaient leurs études interrompues ou avaient à défendre les intérêts de leur famille. Il était donc fréquent de voir rôder dans les villes des groupes d’officiers en uniforme, à peu près libres de service, incertains sur les perspectives que leur réservait l’avenir, mais sûrs que les vigoureux mouvements sociaux qui bouleversaient villes et campagnes représentaient une menace pour leur position sociale. Sur ces jeunes, habitués à l’exercice de la violence et du commandement, la propagande fasciste eut prise facile. Ceci peut bien expliquer la raison de leur participation aux rassemblements de l’extrême droite et aux violences locales contre les manifestations de la gauche et contre les sièges socialistes et syndicaux, dénoncée fréquemment par les représentants de gauche mais aussi enregistrée avec complaisance par les fascistes et leurs soutiens dans l’administration de l’État. En résumé, ces fainéants de luxe constituèrent, surtout dans la période de formation des Équipes d’action, une masse précieuse de manœuvre, une sorte de « garde blanche » de chez nous.
Maintenant nous venons à l’analyse du dernier héritage de l’expérience de guerre, qui explique entre autre aussi le précédent : le soutien que les hiérarchies nationales, et encore plus locales, de l’armée garantirent aux bandes armées fascistes. Les commandements fermèrent les deux yeux face à la participation d’officiers en service aux manifestations fascistes, en violation ouverte de l’apolitisme qui, depuis toujours, constituait une des obligations des militaires italiens. Lorsque ces violations devinrent excessives, ils soutinrent qu’il ne s’agissait pas de manifestations politiques mais d’initiatives patriotiques et que même les violences constituaient simplement des actes de réaction contre les détracteurs de la patrie et de l’armée victorieuse.
Furent rarement inquiétés les officiers qui, commandés en service d’ordre public, avaient participé avec leurs subordonnés aux violences fascistes contre des hommes, sièges et représentants institutionnels de la gauche, au lieu de les protéger. Enfin, les commandements laissèrent souvent à disposition des Équipes d’action armes (même des mitrailleuses et des grenades), camions et parfois automitrailleuses, qui leur permettaient d’obtenir une supériorité inéluctable dans les mouvements des hommes et la vitesse de déplacement.
Pour conclure, les deux études montrent que l’expérience de guerre constitua vraiment l’axe du développement de la violence fasciste. Ceci, pas seulement du point de vue de la rhétorique patriotique et de l’auto-représentation comme défenseurs du « peuple des tranchées » contre les profiteurs de guerre et les embusqués, mais pour la création des dynamiques de groupe qui permirent la cohésion interne en milieux fortement hostiles.
Les volumes de Fabbri et de Reichardt montrent que la gauche italienne n’apprit pas la leçon terrible de modernité que la Grande Guerre laissa en héritage en ce qui concerne l’organisation des masses et leur action, avec l’exception partielle de groupes minoritaires tels les « Arditi del popolo » et certains secteurs du naissant mouvement communiste.
Ironie du sort, les socialistes, l’unique organisation de masse qui depuis toujours avait dénoncé les dangers immenses de la militarisation de la société, et qui s’était affrontée à elle dans les usines et dans la société pendant le conflit, n’avaient pas compris que ces techniques de mobilisation et de gestion de la violence auraient de plus en plus trouvé inévitablement application dans la lutte politique, surtout si celle-ci s’était radicalisée. Les socialistes restèrent convaincus que le conflit social aurait continué à se dérouler avec les mêmes dynamiques et les modalités d’avant guerre, et que la bourgeoisie aurait à la limite choisi la « dictature militaire » et n’aurait pas « adjugé » une guerre civile de basse intensité à une milice de parti qui aurait appliqué la leçon de la Grande Guerre sans aucun frein et sans devoir se plier à n’importe quel contrôle de la part des organes de l’État, même a posteriori.
Enfin, le Parti socialiste ne comprit pas l’autre leçon fondamentale qui venait de l’expérience européenne de la dernière année de guerre et des premiers mois de paix au sujet de la grande capacité de réaction des classes dominantes. Au lieu de décider rapidement dans l’alternative entre révolution et collaboration réformiste, pour ensuite agir en conséquence, il continua à utiliser slogans et programmes maximalistes sans avoir ni l’intention ni le courage d’imiter l’expérience bolchevique. De cette manière, il donna aux forces réactionnaires le temps de s’organiser, d’acquérir l’appui de l’oligarchie politique et économique et d’exercer son hégémonie sur la petite bourgeoisie, même dans ces secteurs qui avaient regardé avec faveur les socialistes dans les mois suivant immédiatement l’armistice.
FABBRI Fabio, Le origini della guerra civile. L’Italia dalla Grande Guerra al fascismo, 1918-1921 (par Marco Pluviano et Irene Guerrini)
Reflets et influences de l’expérience de guerre dans la violence fasciste en Italie de 1919 à 1922 dans la récente production historiographique
(Recension par Irene Guerrini et Marco Pluviano)
Au cours de ces dernières années, deux livres ont été publiés en Italie au sujet de la violence fasciste qui accompagna les années précédant le coup d’État connu comme « la marche sur Rome » : l’étude de l’historien italien Fabio Fabbri, Le origini della guerra civile. L’Italia dalla Grande Guerra al fascismo, 1918-1921, Torino, UTET, 2009, et le travail de l’historien allemand Sven Reichardt, traduit sous le titre Camice nere, camice brune. Milizie fasciste in Italia e in Germania, Bologna, Il Mulino, 2009 (Faschistische Kampfbünde. Gewalt und Gemeinschaft im italienischen Squadrismus und in der deutschen SA, Köln, Bohlau Verlag, 2002).
Il doit être clair qu’il s’agit de deux études différentes entre elles. La première affronte le sujet du développement de la violence du « squadrismo » (l’ensemble des bandes armées fascistes) dans un cadre qui, pour l’auteur, se configure comme une véritable « guerre civile » menée par les fascistes contre les socialistes, les syndicalistes et, à partir de janvier 1921, les communistes, avec le plein soutien des catholiques, des libéraux et du patronat agraire et industriel, de l’armée et de la plupart des organes politiques et administratifs de l’État démocratique.
Le second auteur, par contre, se concentre principalement sur l’analyse des caractéristiques sociales, professionnelles, culturelles des membres des milices fascistes en Italie et en Allemagne, en développant un examen de type comparatif. En outre, il consacre beaucoup d’attention à l’examen des dynamiques de groupe, des mécanismes identitaires, et à l’étude du développement de l’esprit de corps, en mettant ceci en relation avec les origines sociales des individus et avec leur situation professionnelle. En ce qui concerne l’Allemagne, Reichardt détermine dans la « communauté militante » un élément substitutif de la famille pour les jeunes S.A. (Sturmabteilung). Ces derniers, étant victimes du chômage grandissant, laissaient leur famille ou en étaient souvent expulsés, et ils n’étaient pas aptes à s’en créer une propre.
En considération de ceci, et d’autres éléments de grand intérêt, nous voulons analyser ici une des composantes de l’expérience du « squadrismo » italien qui émerge avec vigueur de l’examen des deux ouvrages : l’importance fondamentale de l’expérience de guerre.
On sait bien que la Grande Guerre constitua un des principaux éléments constitutifs pour toutes les forces politiques d’extrême droite dans l’immédiat après-guerre, soit dans les pays dans lesquels elles conquirent ensuite le pouvoir, soit dans ceux dans lesquels l’État démocratique les maintint aux marges, après les avoir éventuellement utilisées dans la lutte anti-prolétarienne.
Ce que montrent les deux livres, c’est que, parlant de l’expérience de guerre, on ne doit pas se limiter à rechercher en elle « l’ADN » du fascisme, mais qu’il faut montrer qu’elle en a accompagné le développement et la croissance d’organisation, en représentant tout d’abord un des facteurs fondamentaux pour la survie et par la suite pour le triomphe du mouvement de Mussolini.
Le rappel de la Grande Guerre ne se limitait donc pas à l’adoption de termes du langage des soldats, ou à la réitération de l’expérience héroïque par antonomase afin de galvaniser les jeunes qui n’avaient connu la guerre que par les journaux, ou l’avaient connue par les récits des frères aînés, ou l’avaient idéalisée à travers la mythisation de la mémoire de quelque conjoint mort au combat. La guerre donna en effet au fascisme les atouts qui permirent à un mouvement ultra-minoritaire de vaincre assez rapidement une organisation socialiste et syndicale très forte, enracinée dans tout le pays, douée d’une expérience d’au moins trente ans dans la mobilisation, et qui ne reculait pas devant l’affrontement physique.
Tout de suite le fascisme assimila les modalités très modernes, au moins pour l’Italie, d’organisation des hommes que la guerre avait développée surtout dans la dernière année et demie. Ce n’est pas un hasard si le corps militaire de référence, soit du point de vue de l’autoreprésentation des « squadristi » (membres des bandes armées fascistes), soit en ce qui concernait l’organisation pratique des « Squadre d’azione » (équipes d’action fascistes), fut celui des « Arditi » (les fantassins spécialement entraînés pour remplir des missions dangereuses), qui avait constitué un des éléments de majeure nouveauté dans l’expérience de guerre italienne. Ainsi, comme les Arditi avaient privilégié l’action démonstrative par surprise, menée par de petits groupes fortement autonomes, commandés par des officiers subalternes, les fascistes basèrent leur stratégie de pénétration et conquête des citadelles rouges – surtout dans les campagnes et les petites villes – sur les équipes d’action. Ces équipes étaient guidées par des jeunes, souvent ex-officiers ou sous-officiers (fréquemment ex-Arditi) ; elles évoluaient avec grande rapidité sur des véhicules fournis par des propriétaires terriens et des industriels ou, souvent, « laissés sans surveillance » par l’armée ; elles visaient toujours à obtenir des résultats symboliques de nature militaire comme, par exemple, la capture des enseignes socialistes, l’élimination du drapeau rouge des sièges communaux administrés par le parti socialiste, l’humiliation publique des dirigeants adverses, la destruction des « centres de commandement » ennemis (Chambre du travail, siège de parti, siège des coopératives). Les expéditions, réalisées souvent la nuit comme les actions des Arditi, avaient la caractéristique d’une incursion plus ou moins longue en territoire ennemi, conduite avec l’objectif de frapper et désarticuler l’organisation adverse, plutôt que de maintenir le contrôle du territoire (à cela on arrivera plus tard, à partir de 1921).
Le lien très étroit des techniques de la violence fasciste et de celles de la guerre fut orgueilleusement revendiqué même par les « gerarchi » (chefs politiques fascistes) locaux et les sommets nationaux, et il servit sûrement pour confirmer, dans la masse des sympathisants, l’identification entre la défense de la patrie menée par les Arditi et celle de la bourgeoisie (soit comme classe sociale, soit comme dépositaire des valeurs de la civilisation face à l’invasion de la marée subversive), défense menée les armes à la main comme le voulait la propagande des disciples de Mussolini.
L’appropriation de l’héritage de guerre ne se limita pas à une aussi essentielle utilisation des tactiques militaires. Un autre instrument décisif que les fascistes réussirent à obtenir et à maintenir solidement fut la participation à leurs entreprises de militaires en service, surtout des officiers. Pour comprendre ceci, il faut considérer que la démobilisation de l’armée italienne fut lente, pour des raisons d’ordre militaire (tensions avec la Yougoslavie voisine, expéditions à l’étranger, conflit de Fiume à partir de l’automne 1919), ou d’ordre politique (utilisation continue de l’armée en service d’ordre public contre des ouvriers et des paysans).
Il y eut encore une autre raison qui contribua à maintenir en service une force disproportionné par rapport aux nécessités : la difficulté de replacer dans le monde du travail les militaires libérés, particulièrement les officiers. Le marché du travail n’offrait pas, en effet, de places suffisantes à la hauteur des aspirations mûries par des hommes qui s’étaient habitués à l’exercice du commandement sans avoir, surtout ceux des dernières levées, les nécessaires compétences culturelles et professionnelles ; à partir de 1917, en effet, pouvaient participer aux cours pour devenir officier de complément les jeunes qui avaient seulement fréquenté au moins deux ans d’institut supérieur. En conséquence de ceci, les officiers restèrent en service en proportion supérieure à celle des soldats, en obtenant aussi l’autorisation de fournir un service très léger dans les villes mêmes où ils reprenaient leurs études interrompues ou avaient à défendre les intérêts de leur famille. Il était donc fréquent de voir rôder dans les villes des groupes d’officiers en uniforme, à peu près libres de service, incertains sur les perspectives que leur réservait l’avenir, mais sûrs que les vigoureux mouvements sociaux qui bouleversaient villes et campagnes représentaient une menace pour leur position sociale. Sur ces jeunes, habitués à l’exercice de la violence et du commandement, la propagande fasciste eut prise facile. Ceci peut bien expliquer la raison de leur participation aux rassemblements de l’extrême droite et aux violences locales contre les manifestations de la gauche et contre les sièges socialistes et syndicaux, dénoncée fréquemment par les représentants de gauche mais aussi enregistrée avec complaisance par les fascistes et leurs soutiens dans l’administration de l’État. En résumé, ces fainéants de luxe constituèrent, surtout dans la période de formation des Équipes d’action, une masse précieuse de manœuvre, une sorte de « garde blanche » de chez nous.
Maintenant nous venons à l’analyse du dernier héritage de l’expérience de guerre, qui explique entre autre aussi le précédent : le soutien que les hiérarchies nationales, et encore plus locales, de l’armée garantirent aux bandes armées fascistes. Les commandements fermèrent les deux yeux face à la participation d’officiers en service aux manifestations fascistes, en violation ouverte de l’apolitisme qui, depuis toujours, constituait une des obligations des militaires italiens. Lorsque ces violations devinrent excessives, ils soutinrent qu’il ne s’agissait pas de manifestations politiques mais d’initiatives patriotiques et que même les violences constituaient simplement des actes de réaction contre les détracteurs de la patrie et de l’armée victorieuse.
Furent rarement inquiétés les officiers qui, commandés en service d’ordre public, avaient participé avec leurs subordonnés aux violences fascistes contre des hommes, sièges et représentants institutionnels de la gauche, au lieu de les protéger. Enfin, les commandements laissèrent souvent à disposition des Équipes d’action armes (même des mitrailleuses et des grenades), camions et parfois automitrailleuses, qui leur permettaient d’obtenir une supériorité inéluctable dans les mouvements des hommes et la vitesse de déplacement.
Pour conclure, les deux études montrent que l’expérience de guerre constitua vraiment l’axe du développement de la violence fasciste. Ceci, pas seulement du point de vue de la rhétorique patriotique et de l’auto-représentation comme défenseurs du « peuple des tranchées » contre les profiteurs de guerre et les embusqués, mais pour la création des dynamiques de groupe qui permirent la cohésion interne en milieux fortement hostiles.
Les volumes de Fabbri et de Reichardt montrent que la gauche italienne n’apprit pas la leçon terrible de modernité que la Grande Guerre laissa en héritage en ce qui concerne l’organisation des masses et leur action, avec l’exception partielle de groupes minoritaires tels les « Arditi del popolo » et certains secteurs du naissant mouvement communiste.
Ironie du sort, les socialistes, l’unique organisation de masse qui depuis toujours avait dénoncé les dangers immenses de la militarisation de la société, et qui s’était affrontée à elle dans les usines et dans la société pendant le conflit, n’avaient pas compris que ces techniques de mobilisation et de gestion de la violence auraient de plus en plus trouvé inévitablement application dans la lutte politique, surtout si celle-ci s’était radicalisée. Les socialistes restèrent convaincus que le conflit social aurait continué à se dérouler avec les mêmes dynamiques et les modalités d’avant guerre, et que la bourgeoisie aurait à la limite choisi la « dictature militaire » et n’aurait pas « adjugé » une guerre civile de basse intensité à une milice de parti qui aurait appliqué la leçon de la Grande Guerre sans aucun frein et sans devoir se plier à n’importe quel contrôle de la part des organes de l’État, même a posteriori.
Enfin, le Parti socialiste ne comprit pas l’autre leçon fondamentale qui venait de l’expérience européenne de la dernière année de guerre et des premiers mois de paix au sujet de la grande capacité de réaction des classes dominantes. Au lieu de décider rapidement dans l’alternative entre révolution et collaboration réformiste, pour ensuite agir en conséquence, il continua à utiliser slogans et programmes maximalistes sans avoir ni l’intention ni le courage d’imiter l’expérience bolchevique. De cette manière, il donna aux forces réactionnaires le temps de s’organiser, d’acquérir l’appui de l’oligarchie politique et économique et d’exercer son hégémonie sur la petite bourgeoisie, même dans ces secteurs qui avaient regardé avec faveur les socialistes dans les mois suivant immédiatement l’armistice.
FLUCHER Guy, Le Chemin des Dames. Du champ d’honneur… au champ des morts, Louviers, Ysec, 2011, 128 p. (par J.F. Jagielski)
L’ouvrage de Guy Flucher se trouve à la croisée de deux disciplines à la fois complémentaires et pourtant différentes de par leurs méthodologies respectives, l’histoire et l’archéologie. Une opinion encore trop souvent répandue veut que les apports de l’archéologie ne puissent être d’une réelle utilité aux historiens de la Grande Guerre du fait de l’importance de la masse documentaire disponible sur ce conflit. L’auteur, lui-même archéologue à l’INRAP de Picardie, montre ici de façon tout à fait convaincante que sur un sujet aussi vaste et complexe que celui de la mort de masse, de sa perception et du traitement des corps durant et après le premier conflit mondial, l’archéologie est également capable d’apporter un certain nombre de réponses précises, là où les documents écrits ou iconographiques comportent parfois des lacunes, des imprécisions ou laissent planer des zones d’ombre et d’incertitude. Cette discipline est aussi capable de confirmer, de nuancer voire d’infirmer la réalité de certaines pratiques funéraires décrites dans la littérature de témoignage dont les auteurs ont une connaissance variable en fonction du poste qu’ils ont occupé sur le front. Plutôt que d’opposer ou de faire entrer artificiellement en concurrence les méthodes de travail propres aux historiens et archéologues, Guy Flucher les rapproche et démontre ainsi combien cette juxtaposition peut être bénéfique aux uns comme aux autres. Lorsque demeurent certains points obscurs, singuliers ou contradictoires, capables de résister à l’investigation historique et archéologique, l’auteur fait montre d’une sage prudence dans son analyse et se garde bien de généraliser à partir de quelques cas isolés (crémation des corps, pratiques discriminantes à l’égard du corps de l’ennemi, sens des pratiques dans le cas des réinhumations définitives dans les nécropoles de regroupement).
Soulignons d’abord la grande richesse des sources utilisées dans cette étude aux contours géographiques volontairement limités et circonscrits au Chemin des Dames et à ses abords immédiats ou plus lointains. Le recours aux témoignages de combattants, aux diverses sources administratives civiles et militaires, aux travaux de nombreux historiens, aux photographies et cartes postales, au fonds d’archives particulièrement riche des sépultures militaires de Laon mais également à la fouille archéologique in situ donnent à cette étude les assises d’un travail nourri, rigoureux et – oserions-nous dire – la forme d’un ouvrage particulièrement « fouillé » malgré sa concision. La problématique de l’ouvrage, clairement exprimée dans l’introduction, rejoint celle des historiens qui se sont penchés sur la question de la mort, de sa perception et des différents rites funéraires qui l’ont entourée. Toutefois l’approche archéologique permet d’aller plus loin et surtout de vérifier, concrètement, in situ, ce qu’avait laissé entendre aux historiens les textes ou les photographies sur les différences de pratiques entre les Français et les Allemands quant au traitement des corps de leurs soldats ou de ceux de l’ennemi. L’approche archéologique permet par ailleurs de mieux connaître un autre aspect important et souvent ignoré de la gestion de la mort, celui des causes matérielles et administratives à l’origine des multiples exhumations et réinhumations des corps au cours de la guerre et de l’immédiate après guerre. Après avoir replacé l’objet de son étude dans un contexte culturel plus large (évolution des pratiques funéraires au XIXe siècle, contexte particulier d’une guerre où la mort fait une irruption massive, diversité de traitement en fonction des nationalités et des religions), l’auteur aborde dans le chapitre III la délicate question de la crémation des corps au début du conflit, des rites d’apprêtement, des objets qui accompagnent la mort et de l’orientation des sépultures.
La deuxième partie de l’ouvrage présente une typologie claire et précise des formes d’inhumation. Cette classification montre combien les formes adoptées furent variées, reflétant en cela la diversité de la zone de l’avant où furent pratiquée la majeure partie des inhumations, qu’elles soient volontaires ou accidentelles dans le cas de corps ensevelis dans les trous d’obus par des tirs d’artillerie. Distinguant les sépultures simples isolées, groupées en cimetières communaux ou temporaires des fosses communes dont les tailles furent variables, l’auteur souligne l’extrême variété des conditions d’inhumation, hâtives ou soignées, visant à se débarrasser au plus vite des cadavres encombrants ou, au contraire, reconstituant lorsque les conditions matérielles le permettent une forme de rationalité dans la gestion de la mort assez proches de celle des cimetières civils. L’observation archéologique atteste aussi de la capacité d’adaptation des multiples services de l’armée qui furent en charge du traitement des corps, soulignant le recours à des procédures la plupart du temps dictées par les circonstances : coexistence de nouveaux cimetières dans la zone de l’arrière-front et inhumations en tranchées lors de grandes offensives pourvoyeuses d’une mort de masse. Une analyse méthodique des signalisations horizontale et verticale des tombes confirme tout à fait ce que nous disent les témoignages de combattants sur la volonté de préserver – lorsque l’idéal n’est pas contrarié par des situations extrêmes de combat – à la fois l’unicité et l’identité des corps inhumés. Le grand nombre et l’extrême diversité des marqueurs horizontaux (croix, stèles, Gedenkesteine allemandes) sont aussi des moyens qui permettent de signaler la nationalité, l’origine ethnique, la religion ou les hiérarchies sociales des corps inhumés. L’auteur confirme ici ce qui nous était apparu dans une étude antérieure, à savoir que les Allemands avaient développé dans leurs cimetières des formes moins standardisées de signalisation des tombes que la simple croix de bois française. La forte augmentation de la mortalité dans l’espace réduit de la zone de l’avant a créé la nécessité de repenser l’aménagement des espaces capables d’accueillir les morts. Là encore, les mesures prises par l’autorité militaire ont été dans la plupart des cas fortement tributaires de ce qui existait déjà : occupation des cimetières des communes proches de la ligne de front et création d’espaces annexes jouxtant ces lieux d’inhumation. Mais certains de ces espaces furent rapidement saturés, tout particulièrement dans les zones d’offensives ou dans celles qui ont accueilli des HOE, importants pourvoyeurs de corps à inhumer. Il fallut donc créer un grand nombre de cimetières ex-nihilo qui prirent la plupart du temps les formes de l’efficacité rationnelle visant à faire face à un impératif quantitatif (alignements, organisation en divisions et présence de tombes aux formes standardisées). L’auteur, en utilisant et croisant différentes sources, constate comme nous avions pu le faire antérieurement, le plus grand soin apporté à l’organisation et l’ornementation des cimetières allemands lorsqu’ils ne sont pas implantés en zone de combats intensifs. Sur ce point particulier, la reproduction de divers plans d’aménagement de cimetières provisoires allemands aujourd’hui pour la plupart disparus, et que nous n’avions pu consulter, est particulièrement probante. A la fin du chapitre VII, cette étude propose une synthèse des contraintes entravant l’inhumation en sépulture simple qui nous paraît là encore tout à fait pertinente et avérée.
La troisième partie de l’ouvrage est consacrée à la sortie de guerre, période particulièrement riche et complexe qui va aboutir à la création des nécropoles nationales et à la délicate question du rapatriement des corps. Sur ce dernier point, contrairement aux autres nations belligérantes, après nombre de tergiversations et de débats très polémiques côté français, les familles auront la liberté ou de rapatrier les corps de leurs défunts ou de les laisser reposer aux côtés de leurs camarades dans les vastes cimetières de regroupement de l’ancienne zone de front. Les deux procédures seront financièrement prises en charge par l’Etat. Toutefois, ces démarches ne purent aboutir pour certaines familles qu’après une longue et pénible quête d’une tombe dans les espaces de chaos de l’après guerre. Nombre de corps non identifiables ou non localisés constituèrent la catégorie des disparus. L’ampleur de la tâche dans le cadre des rapatriements fut lourde, complexe à organiser et donc lente à réaliser, objet de nombreuses polémiques entre les familles et les services de l’Etat en charge de ces transferts. Le grand nombre d’intervenants dans les opérations de réinhumation, l’état de décomposition plus ou moins avancé des corps, la présence ou non d’éléments identificatoires rendirent ces tâches particulièrement difficiles. Elles se firent la plupart du temps sous la pression des familles qui aspiraient toutes à recueillir au plus vite les restes de leurs parents, tout en dénonçant certaines pratiques mercantiles scandaleuses au moment de la mise en adjudication de certains secteurs confiés à des entreprises privées. Diverses fouilles archéologiques à l’emplacement de cimetières provisoires confirment les reproches adressées par les familles aux services de l’Etat-civil ou à ces adjudicateurs en démontrant que, dans bien des cas, seules des bribes de corps avaient été récupérées et réinhumées. Ces réinhumations définitives furent diverses : carrés militaires, nécropoles nationales dotées d’ossuaires ou, dans de rares cas, maintien et réaménagement d’une tombe isolée. Une nouvelle et pérenne signalisation horizontale et verticale des tombes fut mise en place, visant à respecter au mieux les caractères nationaux et religieux des sépultures définitives. Les indications d’ordre hiérarchiques demeurèrent toujours très discrètes, et ce, quelle que soit la nation envisagée. L’organisation finale de ces nécropoles montre que les anciennes nations belligérantes ont opéré des choix qui leur étaient propres et qui, dans l’ensemble, respectaient à la fois des pratiques culturelles déjà bien ancrées mais aussi un souci de gestion simplifiée de ces vastes espaces de regroupement avec, par exemple, le progressif arasement des tertres chez tous les anciens belligérants. Le cas allemand demeurant quant à lui très contraint dans le temps puisque ce n’est qu’en 1966 que le VKD obtiendra par un accord avec les autorités françaises le droit d’intervenir de façon autonome dans les nécropoles qu’il entretenait.
La quatrième et dernière partie de l’ouvrage est consacrée à l’inhumation de ce que l’auteur nomme « les réprouvés ». Bénéficiant des apports récents d’études historiques qui nous permettent désormais de mieux connaître ce type d’hommes en guerre et qui, par ailleurs, ne furent pas tous des militaires, cette partie constitue à n’en pas douter un apport original et tout à fait novateur qui méritait une étude précise. Mesure et prudence s’imposent dans le cas du traitement du corps de l’ennemi où, faute d’analyses exhaustives difficilement réalisables à partir de la masse des archives des sépultures militaires, l’auteur s’appuie sur quelques cas précis pour démontrer combien les pratiques furent différentes, plus souvent dictées par des impératifs matériels ou circonstanciels que par des orientations idéologiques significatives. Dans les cimetières provisoires, les pratiques les plus répandues furent l’intégration, la relégation ou la spécification d’un espace réservé. L’auteur note cependant que les discriminations envers les corps de l’ennemi purent être plus importantes pour les sépultures isolées ou celles recueillant les restes de corps anonymes. Ce que confirme d’ailleurs – chiffres à l’appui – une fouille archéologique réalisée dans le secteur de Soissons. En abordant la question des « morts hors l’honneur » (soldats fusillés, suicidés, espions, prisonniers), Guy Flucher montre que, dans le cas des soldats fusillés, le traitement de leurs tombes individuelles fut absolument identique à celui de leur camarades morts au combat. Il observe toutefois une nuance, dans les cas d’exécution groupée où les inhumations furent collectives et, par la suite, dans l’absence de prise en compte du devenir de la tombe par les services de l’Etat. Dans le cas de soldats français arrêtés et exécutés tardivement en zone occupée par les Allemands, l’auteur observe la plupart du temps des mesures discriminatoires quant aux lieux de leur inhumation. Le cas des espions civils – réels ou supposés mais exécutés comme tels – montre qu’ils furent généralement inhumés en sépulture individuelle isolée, la plupart du temps au sein d’un cimetière. L’auteur observe que de façon générale, et contrairement aux pratiques anciennes, les morts « hors l’honneur » de ce conflit ne semblent pas avoir globalement subi de traitements dégradants post-mortem. Groupant, à juste titre nous semble-t-il, les prisonniers dans cette catégorie des « réprouvés » de la guerre, les observations de Guy Flucher soulignent un traitement empreint d’une réelle dignité, essentiellement motivée par le respect global des conventions internationales et le rôle des inspections des organes de contrôle du CICR. Les travailleurs nationaux, étrangers ou certaines victimes civiles décédés durant la guerre obtinrent généralement un traitement postérieur à leur mort assez identique à celui des usages de la vie civile et bénéficièrent dans la majorité des cas, après enquête administrative, des « avantages » de la mention « morts pour la France ». Ajoutons enfin qu’une riche iconographie (légendée mais n’indiquant pas toujours la source du document) ainsi que la présence de certains relevés de fouilles archéologiques ou de schémas explicatifs, complètent et précisent le contenu cette étude documentée et rigoureuse.
Jean-François Jagielski, septembre 2011
Recensé :
Guy FLUCHER, Le Chemin des Dames. Du champ d’honneur… au champ des morts, Louviers, Ysec, 2011, 128 p.
FLUCHER Guy, Le Chemin des Dames. Du champ d’honneur… au champ des morts, Louviers, Ysec, 2011, 128 p. (par J.F. Jagielski)
L’ouvrage de Guy Flucher se trouve à la croisée de deux disciplines à la fois complémentaires et pourtant différentes de par leurs méthodologies respectives, l’histoire et l’archéologie. Une opinion encore trop souvent répandue veut que les apports de l’archéologie ne puissent être d’une réelle utilité aux historiens de la Grande Guerre du fait de l’importance de la masse documentaire disponible sur ce conflit. L’auteur, lui-même archéologue à l’INRAP de Picardie, montre ici de façon tout à fait convaincante que sur un sujet aussi vaste et complexe que celui de la mort de masse, de sa perception et du traitement des corps durant et après le premier conflit mondial, l’archéologie est également capable d’apporter un certain nombre de réponses précises, là où les documents écrits ou iconographiques comportent parfois des lacunes, des imprécisions ou laissent planer des zones d’ombre et d’incertitude. Cette discipline est aussi capable de confirmer, de nuancer voire d’infirmer la réalité de certaines pratiques funéraires décrites dans la littérature de témoignage dont les auteurs ont une connaissance variable en fonction du poste qu’ils ont occupé sur le front. Plutôt que d’opposer ou de faire entrer artificiellement en concurrence les méthodes de travail propres aux historiens et archéologues, Guy Flucher les rapproche et démontre ainsi combien cette juxtaposition peut être bénéfique aux uns comme aux autres. Lorsque demeurent certains points obscurs, singuliers ou contradictoires, capables de résister à l’investigation historique et archéologique, l’auteur fait montre d’une sage prudence dans son analyse et se garde bien de généraliser à partir de quelques cas isolés (crémation des corps, pratiques discriminantes à l’égard du corps de l’ennemi, sens des pratiques dans le cas des réinhumations définitives dans les nécropoles de regroupement).
Soulignons d’abord la grande richesse des sources utilisées dans cette étude aux contours géographiques volontairement limités et circonscrits au Chemin des Dames et à ses abords immédiats ou plus lointains. Le recours aux témoignages de combattants, aux diverses sources administratives civiles et militaires, aux travaux de nombreux historiens, aux photographies et cartes postales, au fonds d’archives particulièrement riche des sépultures militaires de Laon mais également à la fouille archéologique in situ donnent à cette étude les assises d’un travail nourri, rigoureux et – oserions-nous dire – la forme d’un ouvrage particulièrement « fouillé » malgré sa concision. La problématique de l’ouvrage, clairement exprimée dans l’introduction, rejoint celle des historiens qui se sont penchés sur la question de la mort, de sa perception et des différents rites funéraires qui l’ont entourée. Toutefois l’approche archéologique permet d’aller plus loin et surtout de vérifier, concrètement, in situ, ce qu’avait laissé entendre aux historiens les textes ou les photographies sur les différences de pratiques entre les Français et les Allemands quant au traitement des corps de leurs soldats ou de ceux de l’ennemi. L’approche archéologique permet par ailleurs de mieux connaître un autre aspect important et souvent ignoré de la gestion de la mort, celui des causes matérielles et administratives à l’origine des multiples exhumations et réinhumations des corps au cours de la guerre et de l’immédiate après guerre. Après avoir replacé l’objet de son étude dans un contexte culturel plus large (évolution des pratiques funéraires au XIXe siècle, contexte particulier d’une guerre où la mort fait une irruption massive, diversité de traitement en fonction des nationalités et des religions), l’auteur aborde dans le chapitre III la délicate question de la crémation des corps au début du conflit, des rites d’apprêtement, des objets qui accompagnent la mort et de l’orientation des sépultures.
La deuxième partie de l’ouvrage présente une typologie claire et précise des formes d’inhumation. Cette classification montre combien les formes adoptées furent variées, reflétant en cela la diversité de la zone de l’avant où furent pratiquée la majeure partie des inhumations, qu’elles soient volontaires ou accidentelles dans le cas de corps ensevelis dans les trous d’obus par des tirs d’artillerie. Distinguant les sépultures simples isolées, groupées en cimetières communaux ou temporaires des fosses communes dont les tailles furent variables, l’auteur souligne l’extrême variété des conditions d’inhumation, hâtives ou soignées, visant à se débarrasser au plus vite des cadavres encombrants ou, au contraire, reconstituant lorsque les conditions matérielles le permettent une forme de rationalité dans la gestion de la mort assez proches de celle des cimetières civils. L’observation archéologique atteste aussi de la capacité d’adaptation des multiples services de l’armée qui furent en charge du traitement des corps, soulignant le recours à des procédures la plupart du temps dictées par les circonstances : coexistence de nouveaux cimetières dans la zone de l’arrière-front et inhumations en tranchées lors de grandes offensives pourvoyeuses d’une mort de masse. Une analyse méthodique des signalisations horizontale et verticale des tombes confirme tout à fait ce que nous disent les témoignages de combattants sur la volonté de préserver – lorsque l’idéal n’est pas contrarié par des situations extrêmes de combat – à la fois l’unicité et l’identité des corps inhumés. Le grand nombre et l’extrême diversité des marqueurs horizontaux (croix, stèles, Gedenkesteine allemandes) sont aussi des moyens qui permettent de signaler la nationalité, l’origine ethnique, la religion ou les hiérarchies sociales des corps inhumés. L’auteur confirme ici ce qui nous était apparu dans une étude antérieure, à savoir que les Allemands avaient développé dans leurs cimetières des formes moins standardisées de signalisation des tombes que la simple croix de bois française. La forte augmentation de la mortalité dans l’espace réduit de la zone de l’avant a créé la nécessité de repenser l’aménagement des espaces capables d’accueillir les morts. Là encore, les mesures prises par l’autorité militaire ont été dans la plupart des cas fortement tributaires de ce qui existait déjà : occupation des cimetières des communes proches de la ligne de front et création d’espaces annexes jouxtant ces lieux d’inhumation. Mais certains de ces espaces furent rapidement saturés, tout particulièrement dans les zones d’offensives ou dans celles qui ont accueilli des HOE, importants pourvoyeurs de corps à inhumer. Il fallut donc créer un grand nombre de cimetières ex-nihilo qui prirent la plupart du temps les formes de l’efficacité rationnelle visant à faire face à un impératif quantitatif (alignements, organisation en divisions et présence de tombes aux formes standardisées). L’auteur, en utilisant et croisant différentes sources, constate comme nous avions pu le faire antérieurement, le plus grand soin apporté à l’organisation et l’ornementation des cimetières allemands lorsqu’ils ne sont pas implantés en zone de combats intensifs. Sur ce point particulier, la reproduction de divers plans d’aménagement de cimetières provisoires allemands aujourd’hui pour la plupart disparus, et que nous n’avions pu consulter, est particulièrement probante. A la fin du chapitre VII, cette étude propose une synthèse des contraintes entravant l’inhumation en sépulture simple qui nous paraît là encore tout à fait pertinente et avérée.
La troisième partie de l’ouvrage est consacrée à la sortie de guerre, période particulièrement riche et complexe qui va aboutir à la création des nécropoles nationales et à la délicate question du rapatriement des corps. Sur ce dernier point, contrairement aux autres nations belligérantes, après nombre de tergiversations et de débats très polémiques côté français, les familles auront la liberté ou de rapatrier les corps de leurs défunts ou de les laisser reposer aux côtés de leurs camarades dans les vastes cimetières de regroupement de l’ancienne zone de front. Les deux procédures seront financièrement prises en charge par l’Etat. Toutefois, ces démarches ne purent aboutir pour certaines familles qu’après une longue et pénible quête d’une tombe dans les espaces de chaos de l’après guerre. Nombre de corps non identifiables ou non localisés constituèrent la catégorie des disparus. L’ampleur de la tâche dans le cadre des rapatriements fut lourde, complexe à organiser et donc lente à réaliser, objet de nombreuses polémiques entre les familles et les services de l’Etat en charge de ces transferts. Le grand nombre d’intervenants dans les opérations de réinhumation, l’état de décomposition plus ou moins avancé des corps, la présence ou non d’éléments identificatoires rendirent ces tâches particulièrement difficiles. Elles se firent la plupart du temps sous la pression des familles qui aspiraient toutes à recueillir au plus vite les restes de leurs parents, tout en dénonçant certaines pratiques mercantiles scandaleuses au moment de la mise en adjudication de certains secteurs confiés à des entreprises privées. Diverses fouilles archéologiques à l’emplacement de cimetières provisoires confirment les reproches adressées par les familles aux services de l’Etat-civil ou à ces adjudicateurs en démontrant que, dans bien des cas, seules des bribes de corps avaient été récupérées et réinhumées. Ces réinhumations définitives furent diverses : carrés militaires, nécropoles nationales dotées d’ossuaires ou, dans de rares cas, maintien et réaménagement d’une tombe isolée. Une nouvelle et pérenne signalisation horizontale et verticale des tombes fut mise en place, visant à respecter au mieux les caractères nationaux et religieux des sépultures définitives. Les indications d’ordre hiérarchiques demeurèrent toujours très discrètes, et ce, quelle que soit la nation envisagée. L’organisation finale de ces nécropoles montre que les anciennes nations belligérantes ont opéré des choix qui leur étaient propres et qui, dans l’ensemble, respectaient à la fois des pratiques culturelles déjà bien ancrées mais aussi un souci de gestion simplifiée de ces vastes espaces de regroupement avec, par exemple, le progressif arasement des tertres chez tous les anciens belligérants. Le cas allemand demeurant quant à lui très contraint dans le temps puisque ce n’est qu’en 1966 que le VKD obtiendra par un accord avec les autorités françaises le droit d’intervenir de façon autonome dans les nécropoles qu’il entretenait.
La quatrième et dernière partie de l’ouvrage est consacrée à l’inhumation de ce que l’auteur nomme « les réprouvés ». Bénéficiant des apports récents d’études historiques qui nous permettent désormais de mieux connaître ce type d’hommes en guerre et qui, par ailleurs, ne furent pas tous des militaires, cette partie constitue à n’en pas douter un apport original et tout à fait novateur qui méritait une étude précise. Mesure et prudence s’imposent dans le cas du traitement du corps de l’ennemi où, faute d’analyses exhaustives difficilement réalisables à partir de la masse des archives des sépultures militaires, l’auteur s’appuie sur quelques cas précis pour démontrer combien les pratiques furent différentes, plus souvent dictées par des impératifs matériels ou circonstanciels que par des orientations idéologiques significatives. Dans les cimetières provisoires, les pratiques les plus répandues furent l’intégration, la relégation ou la spécification d’un espace réservé. L’auteur note cependant que les discriminations envers les corps de l’ennemi purent être plus importantes pour les sépultures isolées ou celles recueillant les restes de corps anonymes. Ce que confirme d’ailleurs – chiffres à l’appui – une fouille archéologique réalisée dans le secteur de Soissons. En abordant la question des « morts hors l’honneur » (soldats fusillés, suicidés, espions, prisonniers), Guy Flucher montre que, dans le cas des soldats fusillés, le traitement de leurs tombes individuelles fut absolument identique à celui de leur camarades morts au combat. Il observe toutefois une nuance, dans les cas d’exécution groupée où les inhumations furent collectives et, par la suite, dans l’absence de prise en compte du devenir de la tombe par les services de l’Etat. Dans le cas de soldats français arrêtés et exécutés tardivement en zone occupée par les Allemands, l’auteur observe la plupart du temps des mesures discriminatoires quant aux lieux de leur inhumation. Le cas des espions civils – réels ou supposés mais exécutés comme tels – montre qu’ils furent généralement inhumés en sépulture individuelle isolée, la plupart du temps au sein d’un cimetière. L’auteur observe que de façon générale, et contrairement aux pratiques anciennes, les morts « hors l’honneur » de ce conflit ne semblent pas avoir globalement subi de traitements dégradants post-mortem. Groupant, à juste titre nous semble-t-il, les prisonniers dans cette catégorie des « réprouvés » de la guerre, les observations de Guy Flucher soulignent un traitement empreint d’une réelle dignité, essentiellement motivée par le respect global des conventions internationales et le rôle des inspections des organes de contrôle du CICR. Les travailleurs nationaux, étrangers ou certaines victimes civiles décédés durant la guerre obtinrent généralement un traitement postérieur à leur mort assez identique à celui des usages de la vie civile et bénéficièrent dans la majorité des cas, après enquête administrative, des « avantages » de la mention « morts pour la France ». Ajoutons enfin qu’une riche iconographie (légendée mais n’indiquant pas toujours la source du document) ainsi que la présence de certains relevés de fouilles archéologiques ou de schémas explicatifs, complètent et précisent le contenu cette étude documentée et rigoureuse.
Jean-François Jagielski, septembre 2011
Recensé :
Guy FLUCHER, Le Chemin des Dames. Du champ d’honneur… au champ des morts, Louviers, Ysec, 2011, 128 p.
ROYNETTE Odile, Les mots des tranchées, Paris, Armand Colin, 2010, 286 p. (par Alexandre Lafon)
A-t-il existé une « langue des tranchées » ?
Les mots sont des armes[1]. Et il est heureux de profiter de l’érudition d’Odile Roynette qui s’applique sur cette question à comprendre la genèse et les fonctions prises par ce que l’on nomme la « langue combattante » dite aussi « langue poilue » durant la Grande Guerre. Cette dernière fut mise en valeur par différents lettrés et médias contemporains et utilisée à la fois comme outil de mobilisation, d’études et de récupération esthétique. Mais au-delà, travailler sur cette « langue de guerre » permet aussi, souligne l’auteur, de cerner « de plus près l’ethos combattant » et ainsi approfondir la connaissance des expériences de guerre vécues par les acteurs combattants. L’entreprise, fondée entre autres sur les travaux de linguistique de Pierre Bourdieu, a le mérite d’explorer avec finesse la genèse et la cristallisation du vocabulaire de guerre. Dire, nommer, c’est construire effectivement de l’identité, s’approprier la guerre et dénoncer l’ennemi. Le premier conflit mondial apparaît de ce point de vue comme un laboratoire de la diffusion d’un lexique cantonné avant 1914 dans le domaine de l’argot militaire et devenu pour certains durant le conflit le vecteur de la création d’une langue nationale. Ainsi, la Grande Guerre se serait jouée aussi sur le terrain linguistique.
Un apport certain sur le terrain de la compréhension du lexique combattant
L’ouvrage divisé en six chapitres commence par une étude de la diffusion dans l’espace public de la notion de « langue poilue », mise en lumière dès 1915 dans les journaux de tranchées, puis par certains auteurs combattants à travers lexiques et articles publiés dans la presse grand public. La langue semble alors devenir un enjeu identitaire national. Le second et le troisième chapitres dévoilent le rôle joué par les spécialistes des sciences du langage et les écrivains-combattants qui s’emparent de ce « front de la langue » : les linguistes Albert Dauzat et Gaston Esnault, tout deux soldats, s’emploient en effet à étudier ce qui, dans un premier temps, a été rejeté comme un non-objet linguistique : l’argot des tranchées. Pour les deux protagonistes, il existe bien un « argot poilue », forgée dans la guerre à partir de l’apport de plusieurs sources : langue populaire, argot parisien, langues régionales. Ainsi, « la guerre met en lumière des manières de parler qui ne sont pas propres aux soldats, mais que l’expérience combattante modèle en profondeur et transforme. La « langue poilue », c’est la langue de la nation en guerre et pas seulement celle de l’armée (…) », souligne Odile Roynette à propos des conclusions de Gaston Esnault. Henri Barbusse ou Roland Dorgelès ne s’y sont pas trompés en utilisant le lexique argotique parlé qu’ils ont relevé lors de leur séjour au front et dont ils font un abondant « usage littéraire ». Le critique de témoignage Jean Norton Cru a d’ailleurs reproché à Barbusse cet usage qui ne correspondait pas, selon lui, à la réalité du parler des tranchées[2], sans comprendre au dire d’Odile Roynette, en quoi Barbusse écrit un roman sur « le ravage du consentement » à la guerre (p. 90).
La Grande Guerre hérite comme le souligne bien l’auteur dans le chapitre 4, de différentes strates historiques et linguistiques en termes de vocabulaire. Elle réactive l’intérêt des chercheurs contemporains de la guerre pour la « langue verte » dans le cadre de la structuration de la « nation linguistique » (p. 130). L’argot militaire s’avère ainsi un substrat important et Odile Roynette montre à la fois son évolution lexicale, et l’affirmation sociale de ce parler comme témoignage de la place prise par l’armée dans la Nation. Cette contextualisation fine montre combien la conscription a transformé le dire militaire (p. 120 par exemple), et imposé des codes linguistiques que la guerre remodèle un peu plus dans le contexte d’une mobilisation nationale. Ainsi, les mots des tranchées empruntent au monde militaire et à ses métaphores fertiles, depuis celles de la caserne jusqu’à celles plus exotique de l’expérience coloniale. Ils intègrent effectivement dans cette genèse l’argot parisien et quelques tournures héritées des régiments provinciaux. Il s’agit alors par exemple pour les locuteurs, à travers des tournures humoristiques et/ou métaphoriques, de dévaluer le grade, d’atténuer l’imposition du pouvoir symbolique et physique. Le vocabulaire s’enrichit également dans la guerre de néologismes inspirés par les conditions du combats que ce soit en rapport aux armes employées, aux formes du combat et à l’importance des sens dans l’environnement combattant (apparition du terme « roquet » pour désigner par exemple le canon de 75 mm français). On y apprend ainsi une foule de renseignements sur l’origine de tels ou tels mots ou expressions comme « pousse-caillou », « ramdam » ou « avoir les colombins ». On perçoit la subtilité des mécanismes linguistiques qui en marquent les transformations de sens durant la guerre, comme le glissement de l’utilisation du mot « as » de la cavalerie à l’aviation, ou celui du mot « bousiller » encore utilisé aujourd’hui. Odile Roynette souligne ainsi la malléabilité de la langue de guerre qu’elle cherche à circonscrire, et qu’elle explore de manière extrêmement intéressante le même processus du côté de l’allemand et de l’anglais, et ce dans une plage chronologique permettant de replacer dans ce domaine et à sa juste place l’événement Grande Guerre.
Le chapitre 5 s’applique à rechercher dans les « paroles combattantes », au plus près du « dit » des soldats, cette appropriation linguistique. En cela, les combattants n’ont pas fait œuvre d’originalité, comme le suggère l’auteur, qui voit dans la formation de ce lexique un savoir-faire langagier hérité. Et si les combattantes enrichissent encore le vocabulaire de l’oralité populaire, c’est essentiellement pour s’approprier la guerre, « garder prise » sur les changements opérés dans leur vie, donner sens à « l’expérience sensible », « reconquérir une part de liberté » et se forger une identité de groupe. En ce sens, l’auteur fait heureusement référence à l’utilisation du mot « poilu » dont elle souligne qu’il fut davantage usité qu’on ne l’a écrit par les combattants eux-mêmes (p. 214). Effectivement, les témoignages écrits combattants le confirment : il ne fut pas seulement un mot de l’arrière.
Au final, nombre d’expressions et métaphores liées aux formes prises par la guerre moderne (« front », « mobilisation », « tranchée ») intègrent rapidement le cœur de la société civile. Dans le dernier chapitre, Odile Roynette tente d’interroger le degré de pénétration de cette « langue poilue » dans la sphère sociale et son imaginaire, en s’appuyant sur plusieurs exemples empruntés à la correspondance, aux discours de Clemenceau, à l’étude des journaux à travers le prisme de l’étude du grammairien Georges Prévot datée de 1918. Ce processus de diffusion, nous dit l’auteur, a pour corollaire d’« exprimer la place désormais acquise par la guerre dans l’espace social ».
Une dimension sociale pourtant minimisée
Au regard de cette problématique forte intéressante, plusieurs réserves nous semblent pourtant importantes à souligner quant à l’approche choisies pour cette étude des « mots des tranchées ». Odile Roynette ne se trompe pas en en faisant l’objet d’une enquête poussée. Plus que pour d’autres conflits, les mots ont été mobilisés, et en premier lieu dans un discours légitime et massivement diffusé pour dire le combat et la capacité des combattants à s’adapter et à « consentir » à leur devoir. Mais le danger pour l’historien est bien de glisser de la perception du discours dominant et des représentations vers les pratiques réelles et au final, l’affirmation de la réalité d’une « langue poilue » générique.
L’auteur souligne pourtant à plusieurs reprises le danger de ne percevoir ce langage, s’il existe, qu’à travers le prisme des auteurs qui s’y sont intéressés. Ainsi, sur la question linguistique appliquée au Feu de Barbusse, l’auteur veut voir dans l’abondance des dialogues empruntant à l’argot militaire, un moyen de conjurer la peur, de donner à lire la transformation de l’homme en combattant, un témoignage de la violence des combats qui impacte les formes de la communication. Derrière se dévoilerait l’existence de la « culture de guerre », laissée au singulier, et l’ensauvagement des hommes. Pourtant, la confrontation de la correspondance de l’écrivain Barbusse avec son œuvre offre une autre lecture, celle d’un romancier mu par la volonté de témoigner de la guerre, certes, mais aussi de sa rencontre avec le « peuple », tout comme de sa volonté de montrer que la guerre, arrivée à ce point, doit se terminer et qu’il faut aller jusqu’au bout. A aucun moment, sauf au détour de quelques fins de phrases, Odile Roynette ne met en perspective l’identité sociale de Barbusse, de Dorgelès ou d’Arnoux. Pourtant, derrière le langage cru se cache le désir d’œuvres esthétiques s’appuyant sur cette curiosité vis-à-vis des masses rencontrées dans les tranchées, et ce souci de rendre légitime un langage combattant qui affirme l’existence d’un véritable groupe. Il y a la confrontation entre des hommes issus de la bourgeoisie et la « masse » dans le quotidien de la guerre, le souci de montrer le partage d’une même vie, ou en tout cas, la rencontre de la nation en guerre.
Plus généralement, comme le souligne l’auteur, les pratiques langagières transparaissent à travers « les enquêtes menées par des lettrés » (p. 188). Albert Dauzat ou Gaston Esnault font du langage un objet d’étude ethnologique. Il en va de même finalement d’Henri Barbusse. Ainsi, effectivement la langue passe par le filtre des chercheurs qui s’y intéressent, des lettrés qui la relèvent, les écrivains qui en font leur support d’écriture. C’est pour cette raison qu’il nous semble important de ne pas faire de la langue parlée autre chose qu’une appropriation du vécu, et un formidable terrain de circulation des mots. « Il convient de d’être particulièrement attentif à ce geste anodin qui, en créant un lien entre le dehors et le dedans autorisé par l’ouverture de la bouche, permet d’éprouver sa présence au monde » (p. 199), écrit l’auteur. Il paraît plus juste, à mon sens, d’insister sur l’importance prise par ces « temps » sociaux de communication, de partage que sont les repas, tous pris en commun, entre hommes, en différenciant justement les groupes qui les composent, et donc les mots qui circulent.
Mais Odile Roynette elle-même, en évoquant les « hommes dépourvus de capital culturel », se place elle-même dans une position de jugement et une position culturelle dominante. Elle ne s’appuie donc que sur des sources issues de cette culture dominante. A ce titre, les journaux de tranchées ou la correspondance de l’agrégé Jules Isaac avec sa femme peintre Laure sont-il réellement des sources judicieuses pour prendre la mesure du sens donné (ou non) par l’ensemble des locuteurs aux « mots des tranchées » ? Le risque est bien de délimiter, normer un processus ou des usages à partir d’une seule catégorie sociale. A trop s’appuyer sur les travaux de Gaston Esnault, dont les correspondants sont issus de la même catégorie sociale ou presque, on oublie peut-être le regard socialement marquée sur ce qui est appelé par les linguistes argot, langue verte ou langue de guerre. Il manque donc la profondeur sociale nécessaire, et l’exploration de « l’usage différent » (p. 181) des mots et du sens qu’ils peuvent prendre. D’autant qu’Odile Roynette doute de l’existence réelle d’une « langue poilue » dans un passage qui nous paraît essentiel à propos de l’œuvre de Maurice Genevoix, Sous Verdun : « A lui [Maurice Genevoix], comme à nous, s’impose ainsi l’évidence que l’expérience de la guerre ne traverse pas de la même manière la parole des combattants et qu’elle laisse subsister d’importantes différences. En sorte qu’il n’existerait pas une « langue poilue », mais une infinité d’usages, difficilement saisissables » (p. 99). Pourquoi dès lors, ne pas avoir creusé ce riche sillon ?
Seuls les termes propres à soutenir la démonstration sont décortiqués. L’acronyme PCDF (« pauvre couillon du front ») par exemple, et tous les mots mettant à mal l’autorité (sobriquets et autres jeux de mots) auraient mérité à notre sens une plus juste place dans cette étude qui se veut inscrite dans l’étude des enjeux de pouvoir dans l’économie des échanges linguistiques. Ainsi, n’aurait-il pas fallu approfondir la question de l’opposition par le langage à l’autorité officielle (p. 193) ?
Un système de « penser la guerre » étouffant
Décidément, le corps de l’ennemi et la manière de le nommé est à la mode dans certains récents ouvrages portant sur la Grande Guerre.
De nombreuses études ont pourtant montrées de manière assez convainquante, la complexité du regard que les combattants français en particulier, mais c’est aussi valable du côté allemand ou britannique, pouvaient porter, sur le champ de bataille au « contact » avec leurs adversaires. Il ne se limite en aucun cas à une animalisation. Dans le même ordre d’idée et plus généralement, doit-on faire de l’utilisation des mots du « corps », là encore, un phénomène qui laisse entrevoir violence et brutalisation ? Faut-il être uniquement combattant pour utiliser des expressions obscènes qui mettent en scène le corps ? Autant on peut suivre l’auteur sur l’importance prise par les objets qui environnent les combattants et qui font justement l’objet d’une dénomination imagée, autant sur la question du « corps », il est difficile de s’engager dans des interprétations uniquement tendues vers le même triptyque : « consentement », « brutalisation » et « culture de guerre ». Si Odile Roynette a conscience, et elle l’énonce à plusieurs reprises, des limites de la connaissance du contexte d’énonciation des mots relevés, de l’importance du groupe dans lequel se déploie le langage fleuri des combattants, son propos vise toujours et se ramène constamment à souligner le courage, le consentement des soldats dont elle étudie l’oralité. Il nous semble que cette étude aurait méritée de ne pas rester enclaver dans un système d’interprétation tellement rigide que l’auteur n’interprète ses sources que pour mieux le mettre en valeur, et non l’inverse. Ainsi, la notion de « culture de guerre » en particulier réapparaît quasiment en fin de chaque chapitre : chacun d’eux venant démontrer en fait son existence. L’emploi répété du terme « cathartique » ou « traumatisant » (la guerre est « d’emblée traumatisante » (p. 138)) révèle aussi de cette difficulté de penser la guerre autrement que dans le contexte de cette imprégnation structurante. Quelques répétitions[3] et figures de style aussi brouillent le propos. Ainsi, en évoquant le journal du jeune Yves Congar, témoin de l’occupation allemande : « Il est frappant de constater que le terme « poilu » par exemple, si chargé d’affects, n’est jamais utilisé par le diariste, qui, il est vrai, ne voit aucun soldat français jusqu’à la fin du conflit ». Est-ce alors réellement frappant ?
Nombre d’interprétations mériteraient beaucoup plus de nuances. Mais voilà, il faut encore montrer à tout prix l’aspect « totalisant » de la guerre, et lorsque Clemenceau mobilise le verbe et l’argot guerrier, c’est évidemment « à un niveau jamais atteint », sans que cela soit réellement démontré.
Au final, l’ouvrage d’Odile Roynette apparaît comme un exercice le plus souvent stimulant et met en lumière l’importance de la mobilisation des mots, des processus de construction de codes linguistiques que la guerre nationale, moderne et démocratisée, diffuse par différents canaux. Mais c’est bien du côté des présupposés que pêche la démonstration, qui auraient mérité de s’attarder sur la question des identités sociales pour mieux appréhender encore l’enjeu du « dire » combattant.
Lafon Alexandre – Université de Toulouse II – septembre 2011
Recensé:
Odile ROYNETTE, Les mots des tranchées, Paris, Armand Colin, 2010, 286 p.
[1] Odile Roynette prête à Antoine Prost l’expression « dire, c’est faire », pourtant présente dans la traduction française du livre du philosophe britannique John Langshaw Austin, Quand dire c’est faire, publié en anglais en 1962, How to do Things with Words – cité dans BOURDIEU Pierre, Ce que parler veut dire, Paris, Fayard, 1982, p. 103.
[2] Cru parle à propos de l’utilisation de l’argot par Barbusse de « l’artificiel qu’a un tel étalage ». Et de préciser : « En réalité, on parlait peu l’argot au front, les patois y tinrent une place beaucoup plus grande. En général, on parlait simplement français, un français mêlé d’un peu d’argot de caserne, d’argot colonial, adaptés et un peu augmentés pour les besoins de la guerre », dans CRU Jean Norton, Témoins, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 2006, [1ère éd., Paris, Les Etincelles, 1929], p. 564.
[3] En particulier l’étymologie des mots « boche » ou « poilu ».
Répertoire Guerre 14-18 – Intro

* * *
Pour information, communiqués :
– Octobre 2012
Sortie du livre SAISONS DE GUERRE, Notes d’un combattant de la Grande Guerre (août 1914 – décembre 1918) Gabriel Balique. Plus de détails ici.
– Avril 2013
Sortie du livre 20 ANS, PAYSAN, POÈTE ET… POILU ! aux éditions Jacques Flament : l’histoire, véridique, reconstituée à partir des lettres qu’il adressait à ses parents, d’un paysan de 20 ans qui part en 1914 « défendre son pays » et qui y laisse sa peau, comme tant d’autres. Plus de détails ici.
* * *
Derniers ajouts en date (2013) :
![]() Peintures de guerre 14-18 site (boilletpascalpeintre.free.fr)
Peintures de guerre 14-18 site (boilletpascalpeintre.free.fr)
Artiste professionnel depuis 1985, en Novembre 2012 Pascal BOILLET a célébré 24 ans de « Devoir de Mémoire » en vouant un tiers de son expression picturale à honorer la mémoire des combattants de 1914-1918. Parmi ses nombreuses évocations, l’une des pièces majeures est la série de 12 tableaux créée en 1997 et intitulée » le Chemin de Croix du Poilu de la Grande Guerre.
![]() Ile Longue 14-18 site (ilelongue14-18.eu)
Ile Longue 14-18 site (ilelongue14-18.eu)
Site consacré au camp de prisonniers de l’Ile Longue où furent internés, de 1914 à 1919, des Allemands, des Autrichiens, des Ottomans, des Alsaciens-lorrains…
![]() Monuments aux morts du Nord-Pas-de-Calais dossier (monumentsmorts.univ-lille3.fr)
Monuments aux morts du Nord-Pas-de-Calais dossier (monumentsmorts.univ-lille3.fr)
Ce site étudie dans le détail les monuments aux morts, principalement du Nord-Pas-de-Calais (une extension nationale est prévue).
![]() 1914-1918 online site (1914-1918-online.net)
1914-1918 online site (1914-1918-online.net)
Encyclopédie internationale de la 1ère Guerre mondiale.
![]() Mission du centenaire site (centenaire.org)
Mission du centenaire site (centenaire.org)
La Mission du Centenaire est un groupement d’intérêt public créé en 2012 par le Gouvernement dans la perspective de préparer et de mettre en œuvre le programme commémoratif du centenaire de la Première Guerre mondiale.
![]() World War Gallery site (worldwargallery.com)
World War Gallery site (worldwargallery.com)
600 articles de magazines environ (en anglais) publiés en 1914-1918 qui abordent tous les sujets liés à la Grande Guerre et sont classés dans de multiples thématiques. Corpus mis en ligne par J. Fred MacDonald professeur d’histoire à la Northeastern Illinois University à Chicago, Etats-Unis.
![]() La bataille de Guise article (enenvor.fr)
La bataille de Guise article (enenvor.fr)
A travers l’exemple de la méconnue bataille de Guise, qui se déroule à la fin août 1914, Erwan Le Gall examine les éléments faisant qu’un événement passe ou non à la postérité.
![]() Photos et images 14-18 dossier (photos-images.fr/14-18/)
Photos et images 14-18 dossier (photos-images.fr/14-18/)
Photos aériennes, images et documents de la Grande Guerre de 1914-1918.
![]() Mémoire de la 1ère Guerre Mondiale dossier (lycees.ac-rouen.fr/anguier/memoire/)
Mémoire de la 1ère Guerre Mondiale dossier (lycees.ac-rouen.fr/anguier/memoire/)
Ce site recense des travaux d’élèves de lycée sur la mémoire de la 1ère Guerre mondiale dans leurs communes, ainsi que des photos de monuments, de cartes postales anciennes anciennes, etc.
![]() Mémoire de poilus site (memoiredepoilus.org)
Mémoire de poilus site (memoiredepoilus.org)
Association qui a pour but le devoir de mémoire avec reconstitutions, commémorations, expositions, conférences et interventions en milieu scolaire.
![]() Recueils d’écrits – Bibliothèque numérique de Roubaix notices (bn-r.fr)
Recueils d’écrits – Bibliothèque numérique de Roubaix notices (bn-r.fr)
Recueil d’écrits sur la 1ère Guerre mondiale ; Journal de guerre 1914-1915 ; Vieux souvenirs de guerre 1914-1915 ; Roubaix pendant l’occupation allemande
![]() Dioramas (maquettes) sur la Guerre 14-18 blog (verdun28.skyrock.com)
Dioramas (maquettes) sur la Guerre 14-18 blog (verdun28.skyrock.com)
Dioramas (reconstitutions de scènes sous forme de maquettes) consacrés la 1ère Guerre mondiale. L’auteur participe à des salons ou commémorations où il présente ses dioramas de la Grande Guerre en tenue d’officier d’infanterie de 1914.
![]() Lazare Ponticelli blog (poilus1914.skyrock.com)
Lazare Ponticelli blog (poilus1914.skyrock.com)
Blog sur le dernier Poilu, Lazare Ponticelli.
![]() Les Francs-Tireurs Lorrains site (ftl57.com)
Les Francs-Tireurs Lorrains site (ftl57.com)
Association basée à Metz regroupant des jeunes passionnés d’histoire militaire du XXe siècles qui participent à des reconstitutions historiques et des expositions.
![]() Fédération Grande Guerre site (grande-guerre.eu)
Fédération Grande Guerre site (grande-guerre.eu)
Association oeuvrant à la réalisation d’expositions, ainsi qu’à la mise en place de reconstitutions ou encore de conseils techniques et figurations pour la télévision et le cinéma. Nous proposons également, en qualité de passionnés, des présentations pédagogiques dans le milieu scolaire.
![]() 14-18 effroyable boucherie site (1418effroyableboucherie.fr/)
14-18 effroyable boucherie site (1418effroyableboucherie.fr/)
Site permettant à chacun de référencer des photos et cartes postales au sujet de la première guerre et de la géolocaliser sur google maps.
![]() Hôpitaux militaires en 14-18 blog (hopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com)
Hôpitaux militaires en 14-18 blog (hopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com)
Blog consacré à l’histoire des hôpitaux militaires et du service de santé dans la guerre 1914-1918.
* * *
![]() 4 remarques sur ce répertoire :
4 remarques sur ce répertoire :
-1/ Cette liste de sites Internet et de pages Web n’est pas exhaustive et est appelée à s’enrichir de nouvelles données progressivement. Les sites et pages Web sont vérifiés régulièrement afin d’enlever de ce répertoire les liens obsolètes, néanmoins si entre temps vous constatiez un site hors-ligne, le signaler à Guerre1418.fr serait très apprécié ! (cf. page de contact).
-2/ Les drapeaux qui accompagnent chaque site indiquent la langue utilisée et non son origine géographique. Les sites francophones sont privilégiés, seuls les grands sites étrangers (de type portail) sont référencés ainsi que ceux de moindre envergure qui présentent un contenu intéressant ou original (cartes et photos par exemple).
-3/ Guerre1418.fr ne saurait être tenu pour responsable de la pertinence des informations et données historiques contenues dans ces documents qui n’engagent que leurs auteurs, le rôle de Guerre1418.fr consiste uniquement à pratiquer leur recensement et non leur évaluation.
-4/ Guerre1418.fr est une initiative individuelle sans aucuns rapports avec une quelconque association ou institution.
Répertoire Guerre 14-18 – Intro

* * *
Pour information, communiqués :
– Octobre 2012
Sortie du livre SAISONS DE GUERRE, Notes d’un combattant de la Grande Guerre (août 1914 – décembre 1918) Gabriel Balique. Plus de détails ici.
– Avril 2013
Sortie du livre 20 ANS, PAYSAN, POÈTE ET… POILU ! aux éditions Jacques Flament : l’histoire, véridique, reconstituée à partir des lettres qu’il adressait à ses parents, d’un paysan de 20 ans qui part en 1914 « défendre son pays » et qui y laisse sa peau, comme tant d’autres. Plus de détails ici.
* * *
Derniers ajouts en date (2013) :
![]() Peintures de guerre 14-18 site (boilletpascalpeintre.free.fr)
Peintures de guerre 14-18 site (boilletpascalpeintre.free.fr)
Artiste professionnel depuis 1985, en Novembre 2012 Pascal BOILLET a célébré 24 ans de « Devoir de Mémoire » en vouant un tiers de son expression picturale à honorer la mémoire des combattants de 1914-1918. Parmi ses nombreuses évocations, l’une des pièces majeures est la série de 12 tableaux créée en 1997 et intitulée » le Chemin de Croix du Poilu de la Grande Guerre.
![]() Ile Longue 14-18 site (ilelongue14-18.eu)
Ile Longue 14-18 site (ilelongue14-18.eu)
Site consacré au camp de prisonniers de l’Ile Longue où furent internés, de 1914 à 1919, des Allemands, des Autrichiens, des Ottomans, des Alsaciens-lorrains…
![]() Monuments aux morts du Nord-Pas-de-Calais dossier (monumentsmorts.univ-lille3.fr)
Monuments aux morts du Nord-Pas-de-Calais dossier (monumentsmorts.univ-lille3.fr)
Ce site étudie dans le détail les monuments aux morts, principalement du Nord-Pas-de-Calais (une extension nationale est prévue).
![]() 1914-1918 online site (1914-1918-online.net)
1914-1918 online site (1914-1918-online.net)
Encyclopédie internationale de la 1ère Guerre mondiale.
![]() Mission du centenaire site (centenaire.org)
Mission du centenaire site (centenaire.org)
La Mission du Centenaire est un groupement d’intérêt public créé en 2012 par le Gouvernement dans la perspective de préparer et de mettre en œuvre le programme commémoratif du centenaire de la Première Guerre mondiale.
![]() World War Gallery site (worldwargallery.com)
World War Gallery site (worldwargallery.com)
600 articles de magazines environ (en anglais) publiés en 1914-1918 qui abordent tous les sujets liés à la Grande Guerre et sont classés dans de multiples thématiques. Corpus mis en ligne par J. Fred MacDonald professeur d’histoire à la Northeastern Illinois University à Chicago, Etats-Unis.
![]() La bataille de Guise article (enenvor.fr)
La bataille de Guise article (enenvor.fr)
A travers l’exemple de la méconnue bataille de Guise, qui se déroule à la fin août 1914, Erwan Le Gall examine les éléments faisant qu’un événement passe ou non à la postérité.
![]() Photos et images 14-18 dossier (photos-images.fr/14-18/)
Photos et images 14-18 dossier (photos-images.fr/14-18/)
Photos aériennes, images et documents de la Grande Guerre de 1914-1918.
![]() Mémoire de la 1ère Guerre Mondiale dossier (lycees.ac-rouen.fr/anguier/memoire/)
Mémoire de la 1ère Guerre Mondiale dossier (lycees.ac-rouen.fr/anguier/memoire/)
Ce site recense des travaux d’élèves de lycée sur la mémoire de la 1ère Guerre mondiale dans leurs communes, ainsi que des photos de monuments, de cartes postales anciennes anciennes, etc.
![]() Mémoire de poilus site (memoiredepoilus.org)
Mémoire de poilus site (memoiredepoilus.org)
Association qui a pour but le devoir de mémoire avec reconstitutions, commémorations, expositions, conférences et interventions en milieu scolaire.
![]() Recueils d’écrits – Bibliothèque numérique de Roubaix notices (bn-r.fr)
Recueils d’écrits – Bibliothèque numérique de Roubaix notices (bn-r.fr)
Recueil d’écrits sur la 1ère Guerre mondiale ; Journal de guerre 1914-1915 ; Vieux souvenirs de guerre 1914-1915 ; Roubaix pendant l’occupation allemande
![]() Dioramas (maquettes) sur la Guerre 14-18 blog (verdun28.skyrock.com)
Dioramas (maquettes) sur la Guerre 14-18 blog (verdun28.skyrock.com)
Dioramas (reconstitutions de scènes sous forme de maquettes) consacrés la 1ère Guerre mondiale. L’auteur participe à des salons ou commémorations où il présente ses dioramas de la Grande Guerre en tenue d’officier d’infanterie de 1914.
![]() Lazare Ponticelli blog (poilus1914.skyrock.com)
Lazare Ponticelli blog (poilus1914.skyrock.com)
Blog sur le dernier Poilu, Lazare Ponticelli.
![]() Les Francs-Tireurs Lorrains site (ftl57.com)
Les Francs-Tireurs Lorrains site (ftl57.com)
Association basée à Metz regroupant des jeunes passionnés d’histoire militaire du XXe siècles qui participent à des reconstitutions historiques et des expositions.
![]() Fédération Grande Guerre site (grande-guerre.eu)
Fédération Grande Guerre site (grande-guerre.eu)
Association oeuvrant à la réalisation d’expositions, ainsi qu’à la mise en place de reconstitutions ou encore de conseils techniques et figurations pour la télévision et le cinéma. Nous proposons également, en qualité de passionnés, des présentations pédagogiques dans le milieu scolaire.
![]() 14-18 effroyable boucherie site (1418effroyableboucherie.fr/)
14-18 effroyable boucherie site (1418effroyableboucherie.fr/)
Site permettant à chacun de référencer des photos et cartes postales au sujet de la première guerre et de la géolocaliser sur google maps.
![]() Hôpitaux militaires en 14-18 blog (hopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com)
Hôpitaux militaires en 14-18 blog (hopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com)
Blog consacré à l’histoire des hôpitaux militaires et du service de santé dans la guerre 1914-1918.
* * *
![]() 4 remarques sur ce répertoire :
4 remarques sur ce répertoire :
-1/ Cette liste de sites Internet et de pages Web n’est pas exhaustive et est appelée à s’enrichir de nouvelles données progressivement. Les sites et pages Web sont vérifiés régulièrement afin d’enlever de ce répertoire les liens obsolètes, néanmoins si entre temps vous constatiez un site hors-ligne, le signaler à Guerre1418.fr serait très apprécié ! (cf. page de contact).
-2/ Les drapeaux qui accompagnent chaque site indiquent la langue utilisée et non son origine géographique. Les sites francophones sont privilégiés, seuls les grands sites étrangers (de type portail) sont référencés ainsi que ceux de moindre envergure qui présentent un contenu intéressant ou original (cartes et photos par exemple).
-3/ Guerre1418.fr ne saurait être tenu pour responsable de la pertinence des informations et données historiques contenues dans ces documents qui n’engagent que leurs auteurs, le rôle de Guerre1418.fr consiste uniquement à pratiquer leur recensement et non leur évaluation.
-4/ Guerre1418.fr est une initiative individuelle sans aucuns rapports avec une quelconque association ou institution.